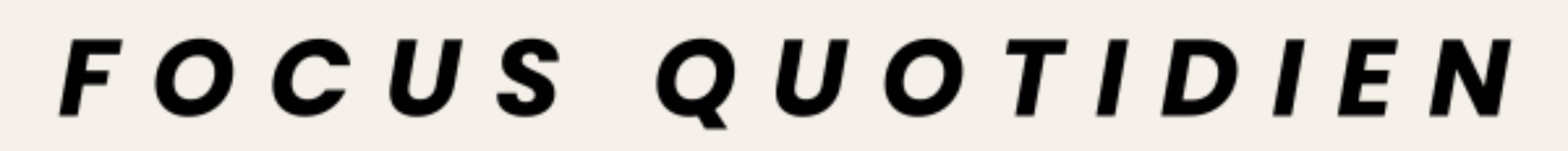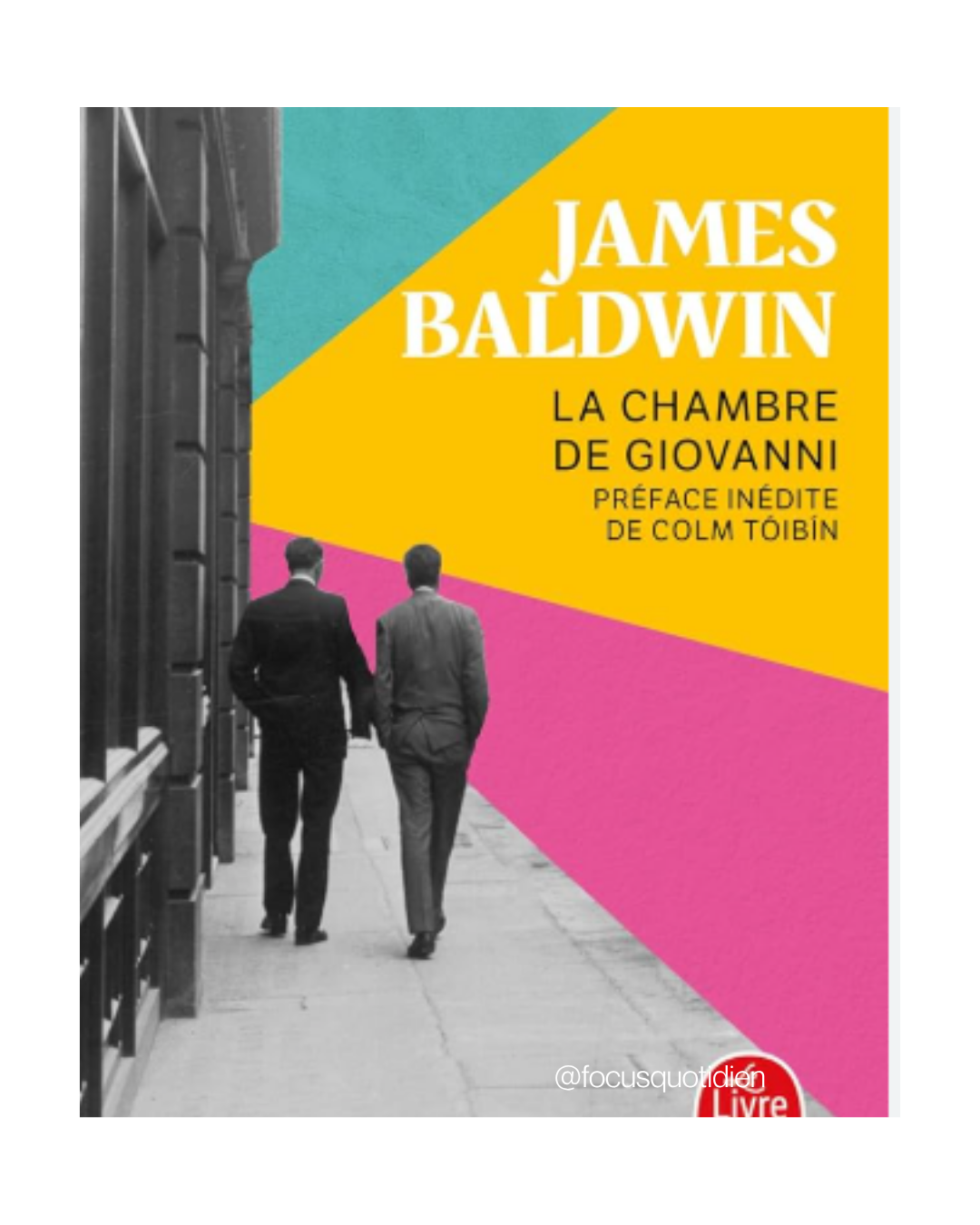À l’heure où la France célèbre la panthéonisation de Robert Badinter, figure de la justice et de la fin de la peine de mort, il semble juste de se tourner vers un autre cri contre la condamnation — non pas celle d’un crime, mais celle de l’amour.
Car La Chambre de Giovanni, de James Baldwin, est bien cela : une condamnation à mort symbolique de l’amour libre, du désir sincère, et de la vérité de soi.
Publié en 1956, ce roman d’une modernité bouleversante s’ouvre déjà sur sa fin : Giovanni, l’homme qui donne son nom au livre, attend son exécution. Le narrateur, David, un Américain dans la trentaine, regarde son reflet dans une vitre. Ce miroir, dès les premières lignes, annonce le thème central du roman : la confrontation avec soi-même.
Baldwin situe son histoire dans un Paris d’après-guerre, à la fois refuge et piège. La ville y devient un personnage à part entière, tour à tour lumineuse et grise, accueillante et hostile, reflet changeant des émotions de ceux qui la traversent.
C’est dans ce décor que naît la relation entre David et Giovanni, un jeune serveur italien rencontré dans un bar. Leur passion s’installe dans une petite chambre — étroite, sale, presque étouffante — qui devient le symbole de leur amour : un espace de promesse et d’enfermement, de douceur et de désespoir.
Mais La Chambre de Giovanni n’est pas seulement une histoire d’amour homosexuel. Baldwin y explore toutes les formes que peut prendre ce sentiment universel. Giovanni, c’est l’amoureux absolu, celui qui se donne tout entier et confère à l’autre le pouvoir de le sauver. David, lui, incarne la peur : peur de ses désirs, peur du jugement, peur d’être lui-même. Peut-on vraiment aimer quand on a peur ?
Hella, la fiancée de David, représente une forme d’amour plus conscient, presque résigné : elle croit à la liberté mais reste persuadée qu’une femme ne peut être pleinement tranquille qu’en étant mariée. Autour d’eux gravitent d’autres figures, autant de miroirs déformants de l’amour : Jacques, l’amoureux matérialiste qui achète l’affection ; Guillaume, l’abuseur qui confond désir et pouvoir ; Sue, la désabusée qui prétend ne plus y croire mais espère encore. Même les clients du bar, spectateurs avides de la beauté de Giovanni, vivent l’amour par procuration, fascinés par ce qu’ils n’osent plus vivre.
Au fil du récit, la plume de Baldwin épouse les mouvements du cœur de David. Quand il s’abandonne à ses sentiments, l’écriture devient tendre, presque caressante. Mais dès que la peur ressurgit, les phrases se durcissent, tranchantes comme un éclat de verre. Baldwin cisèle son texte avec une précision douloureuse — chaque mot semble venir frapper le lecteur au cœur.
Ce roman parle d’amour, mais aussi de courage. À une époque où aimer un homme pouvait mener à la ruine sociale, sinon à la prison (l’homosexualité ne sera dépénalisée en France qu’en 1982), La Chambre de Giovanni pose une question intemporelle : jusqu’où peut-on aller pour être fidèle à soi-même ?
Lorsque David, rongé par la honte, quitte Giovanni pour retourner vers Hella, la tragédie s’accomplit. Giovanni, abandonné, se débat avec sa propre histoire, son humiliation et sa colère — jusqu’à la fatalité. L’amour devient ici une force destructrice, non parce qu’il est impur, mais parce qu’il est empêché.
Et c’est peut-être là que réside la véritable violence du roman : dans le regard que David porte sur lui-même. Ce regard, plus impitoyable encore que celui de la société, il le projette sur le monde pour s’en protéger. Baldwin montre avec une justesse cruelle que c’est souvent notre propre jugement, bien plus que celui des autres, qui nous condamne. David attribue à la société un mépris qu’elle n’exerce peut-être pas — c’est lui qui, incapable d’accepter ses désirs, projette sur Giovanni le dégoût qu’il ressent pour lui-même.
Lâche, il n’a pas le courage d’affronter ce regard intérieur, ce jugement imbibé de bien-pensance et de peur. Il préfère sacrifier celui qui a cru, naïvement, au pouvoir de l’amour, plutôt que d’affronter sa propre vérité.
Car lorsqu’on ne s’aime pas, on finit par croire que l’on n’a pas droit au bonheur. On se punit soi-même, on sabote ce qui pourrait nous rendre heureux, comme si la joie et l’amour étaient réservés à d’autres. Baldwin fait de cette autodestruction intime le cœur battant du roman : la tragédie n’est pas l’amour interdit, mais la conviction intime de ne pas mériter d’être aimé.
Baldwin, avec une justesse inouïe, ne juge pas ses personnages : il les met à nu. La Chambre de Giovanni est moins une histoire d’homosexualité qu’une méditation sur la peur, le courage et la liberté. Et si Badinter a voulu abolir la peine de mort au nom de la dignité humaine, Baldwin, lui, nous rappelle que l’amour aussi meurt chaque fois que la peur triomphe du courage.
Car c’est bien cela, au fond, le drame du roman : la société condamne les Giovanni, mais c’est David qui se condamne lui-même.
Si vous croyez encore à l’amour romantique, à celui qui se vit dans l’abandon et la sincérité plutôt que dans la retenue et la peur, vous ne sortirez pas indemne de cette lecture. La Chambre de Giovanni n’est pas un roman que l’on referme — c’est un miroir qui continue à vous suivre.
Maxime Dorian
La chambre de Giovanni. James Baldwin (édition le livre de poche)